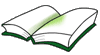Le Fil d’Ariane
Centre de documentation spécialisé en santé mentale
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Catégories


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheLe Banal / Mahmoud SAMI-ALI
Titre : Le Banal Type de document : texte imprimé Auteurs : Mahmoud SAMI-ALI Année de publication : 1980 Importance : 222 p. Langues : Français Catégories : Art
Banalité
Esthétique
Langage
Littérature
Projection
Quotidien
Représentation
SurréalismeMots-clés : Banalité Esthétique Quotidien Représentation Projection Art Surréalisme Littérature Langage Résumé : Ce livre explore les forces qui, dans une société donnée - la nôtre -, poussent à l'uniformité de penser, de sentir et d'être. La forme moderne du "malaise dans la civilisation" ne serait-elle pas la soumission au pouvoir anonyme qu'exerçent ces forces ? L'exigence de penser se dégrade en exigence de conformité quand le réel, assimilé au rationnel et au technique, a force de loi. Pour saisir le banal qui nous envahit jusque dans ce que nous sommes, il faut d'abord l'isoler en tant que concept et c'est l'effort ici entrepris. Il faut ensuite faire travailler ce concept afin de mettre en évidence la torsion que le primat du banal fait subir au réel : fascination par l'identité, exclusion de l'imaginaire. Il faut enfin rechercher les modalités du banal là où il fait le plus radicalement problème dans certaines tentatives esthétiques consécutives ou parallèles au surréalisme - comme celles de Raymond Roussel, de Jacques Rigaut, de Duchamp, de Warhol -, là où la création est devenue une subjectivité sans sujet ; dans une pathologie psychosomatique que l'on peut caractériser simultanément par l'adaptation réussie et par le refoulement de toute activité de rêve ; ou encore dans une expérience mystique qui se voudrait fin de tout discours. A travers cette exploration attentive, minutieuse, de textes ou de cas cliniques, on reconnaîtra à la fois l'emprise qu'exerce le banal, le dévoiement contemporain d'un imaginaire coupé de ses racines subjectives et l'unité de phénomènes appartenant à des champs très divers de l'expérience humaine. En appendice : Test de Rorschach de 2 cas analysés Le Banal [texte imprimé] / Mahmoud SAMI-ALI . - 1980 . - 222 p.
Langues : Français
Catégories : Art
Banalité
Esthétique
Langage
Littérature
Projection
Quotidien
Représentation
SurréalismeMots-clés : Banalité Esthétique Quotidien Représentation Projection Art Surréalisme Littérature Langage Résumé : Ce livre explore les forces qui, dans une société donnée - la nôtre -, poussent à l'uniformité de penser, de sentir et d'être. La forme moderne du "malaise dans la civilisation" ne serait-elle pas la soumission au pouvoir anonyme qu'exerçent ces forces ? L'exigence de penser se dégrade en exigence de conformité quand le réel, assimilé au rationnel et au technique, a force de loi. Pour saisir le banal qui nous envahit jusque dans ce que nous sommes, il faut d'abord l'isoler en tant que concept et c'est l'effort ici entrepris. Il faut ensuite faire travailler ce concept afin de mettre en évidence la torsion que le primat du banal fait subir au réel : fascination par l'identité, exclusion de l'imaginaire. Il faut enfin rechercher les modalités du banal là où il fait le plus radicalement problème dans certaines tentatives esthétiques consécutives ou parallèles au surréalisme - comme celles de Raymond Roussel, de Jacques Rigaut, de Duchamp, de Warhol -, là où la création est devenue une subjectivité sans sujet ; dans une pathologie psychosomatique que l'on peut caractériser simultanément par l'adaptation réussie et par le refoulement de toute activité de rêve ; ou encore dans une expérience mystique qui se voudrait fin de tout discours. A travers cette exploration attentive, minutieuse, de textes ou de cas cliniques, on reconnaîtra à la fois l'emprise qu'exerce le banal, le dévoiement contemporain d'un imaginaire coupé de ses racines subjectives et l'unité de phénomènes appartenant à des champs très divers de l'expérience humaine. En appendice : Test de Rorschach de 2 cas analysés Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2375 L-SAMI Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Le Corps et la psychose : l'objet invisible / Joseph MORNET
Titre : Le Corps et la psychose : l'objet invisible Type de document : texte imprimé Auteurs : Joseph MORNET ; Roger GENTIS Année de publication : 2006 Importance : 161 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-913376-69-4 Langues : Français Catégories : Art
Corps
Image du corps
kinésithérapie
Médecine
Passage à l'acte
Peinture
Psychanalyse
Psychomotricité
Psychose
Psychothérapie institutionnelle
Relation thérapeutique
Représentation
Sculpture
Surréalisme
Symptôme
Thérapie de groupe
TransfertMots-clés : Psychose Corps Image du corps Psychothérapie institutionnelle Thérapie de groupe Psychomotricité Kinésithérapie Relation thérapeutique Transfert Symptôme Passage à l'acte Représentation Psychanalyse Médecine Art Peinture Sculpture Surréalisme Résumé : Si le corps est le lieu privilégié de rencontre avec le psychotique, son soin en institution et sa rencontre avec les spécialistes sont souvent l?occasion d?un malentendu, comme aimait le souligner Maud Mannoni, les obligeant à interroger leurs pratiques et à y ouvrir d?autres fléchages. C?est ce que retranscrit la première partie de ce texte à travers le cheminement des structurations des soins corporels au Centre psychothérapique Saint-Martin de Vignogoul. Nés des maternages individuels ils ont très vite évolué vers d?autres formes de thérapie corporelle, groupales ou individuelles, toujours en place aujourd?hui. Illustrée chaque fois par des comptes rendus cliniques, cette histoire s?accompagne de prolongements théoriques et conceptuels souvent difficiles à élaborer, les thérapies corporelles se situant toujours aux limites du langage. Une réflexion sur les soins corporels et les institutions ne peut s?arrêter à la seule relation soignant-soigné. Le groupe institutionnel a, lui aussi, un corps. Il faut savoir en prendre soin tant il occupe une place privilégiée de projection et de support des dynamiques psychiques qui traversent la vie institutionnelle et s?expriment le plus souvent en symptôme ou passage à l?acte. Enfin, le soin du corps suppose des représentations de ce corps. Trois d?entre elles sont confrontées : celles du médecin, du psychanalyste et de l?artiste. Une étrange familiarité apparaît entre les étapes jalonnant l??uvre d?Alberto Giacometti (ainsi que celle de Francis Bacon) et celles que parcourt le clinicien dans sa rencontre avec le corps du psychotique. Le Corps et la psychose : l'objet invisible [texte imprimé] / Joseph MORNET ; Roger GENTIS . - 2006 . - 161 p.
ISBN : 978-2-913376-69-4
Langues : Français
Catégories : Art
Corps
Image du corps
kinésithérapie
Médecine
Passage à l'acte
Peinture
Psychanalyse
Psychomotricité
Psychose
Psychothérapie institutionnelle
Relation thérapeutique
Représentation
Sculpture
Surréalisme
Symptôme
Thérapie de groupe
TransfertMots-clés : Psychose Corps Image du corps Psychothérapie institutionnelle Thérapie de groupe Psychomotricité Kinésithérapie Relation thérapeutique Transfert Symptôme Passage à l'acte Représentation Psychanalyse Médecine Art Peinture Sculpture Surréalisme Résumé : Si le corps est le lieu privilégié de rencontre avec le psychotique, son soin en institution et sa rencontre avec les spécialistes sont souvent l?occasion d?un malentendu, comme aimait le souligner Maud Mannoni, les obligeant à interroger leurs pratiques et à y ouvrir d?autres fléchages. C?est ce que retranscrit la première partie de ce texte à travers le cheminement des structurations des soins corporels au Centre psychothérapique Saint-Martin de Vignogoul. Nés des maternages individuels ils ont très vite évolué vers d?autres formes de thérapie corporelle, groupales ou individuelles, toujours en place aujourd?hui. Illustrée chaque fois par des comptes rendus cliniques, cette histoire s?accompagne de prolongements théoriques et conceptuels souvent difficiles à élaborer, les thérapies corporelles se situant toujours aux limites du langage. Une réflexion sur les soins corporels et les institutions ne peut s?arrêter à la seule relation soignant-soigné. Le groupe institutionnel a, lui aussi, un corps. Il faut savoir en prendre soin tant il occupe une place privilégiée de projection et de support des dynamiques psychiques qui traversent la vie institutionnelle et s?expriment le plus souvent en symptôme ou passage à l?acte. Enfin, le soin du corps suppose des représentations de ce corps. Trois d?entre elles sont confrontées : celles du médecin, du psychanalyste et de l?artiste. Une étrange familiarité apparaît entre les étapes jalonnant l??uvre d?Alberto Giacometti (ainsi que celle de Francis Bacon) et celles que parcourt le clinicien dans sa rencontre avec le corps du psychotique. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 5253 L-MORN Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Finnegans Wake / James JOYCE
Titre : Finnegans Wake Type de document : texte imprimé Auteurs : James JOYCE Année de publication : 1982 Importance : 923 ISBN/ISSN/EAN : 978-2-07-040225-0 Langues : Français Catégories : Écriture
Langage
Roman littéraire
SurréalismeMots-clés : Roman littéraire Surréalisme Langage Écriture Résumé : Traduit pour la première fois dans sa version intégrale, Finnegans Wake, ?uvre rebelle, s'exprime par épiphanies, telles que définies dans Ulysse - c'est-à-dire ces instants où les mots comme des photons reconstituent la figure d'interférence, visible seulement dans sa frange brillante. Pour certains, la révolution est à peine suffisante. Ils partent, hantent les asiles dont ils font une bibliothèque, habitent les prisons où flotte le feu de leurs rêves, créent un pseudo-langage qui n'est plus entendu mais reconnu de leurs seuls semblables. Errants jusqu'à l'inconsistance, telle la révolutionnaire russe Alexandra Kollontaï : " ... Comme j'aimais Kuusa en septembre... l'odeur des pins et, comme des toiles d'araignées tendues entre eux, les nuages chargés de rosée, au matin. " Réputé comme étant un texte difficile, voire illisible et intraduisible, Finnegans Wake est néanmoins considéré comme un monument de la littérature du XXe siècle. On dit ce livre " traduit de l'anglais " mais, en fait, il mêle plusieurs langues, à un tel point que certains spécialistes prétendent qu'il n'y a pas de langue de départ. Après avoir terminé Ulysse, Joyce pensait qu'il avait achevé l'?uvre de sa vie. Mais bientôt, il se remit au travail pour une ?uvre plus ambitieuse encore. Le 10 mars 1923, il commença un texte qu'il nomma d'abord Work in progress (Travail en cours) et plus tard Finnegans Wake. En 1926, il en avait déjà complété les deux premières parties. Cette année-là, il rencontra Eugène et Maria Jolas qui proposèrent de publier le livre en feuilleton dans leur magazine Transition. Les années suivantes, Joyce travailla rapidement sur ce nouveau livre, mais dans les années 1930, il progressa plus lentement. Cela était dû à plusieurs facteurs, dont la mort de son père en 1931, la santé mentale de sa fille Lucia Joyce et ses propres problèmes de santé, dont une vue qui déclinait. La majeure partie fut terminée avec l'assistance de jeunes admirateurs, parmi lesquels Samuel Beckett. Pendant plusieurs années, Joyce nourrit le projet excentrique de demander à James Stephens de terminer l'écriture du livre, et ce, pour la simple raison que Stephens était né dans le même hôpital que lui exactement une semaine plus tard, et qu'il partageait à la fois le même prénom que lui, et que, de plus, son personnage de fiction (cela est un exemple des nombreuses superstitions de Joyce). Lors de son 57e anniversaire chez les Jolas, Joyce annonça le titre final de son livre et Finnegans Wake fut publié sous la forme d'un livre le 4 mai 1939, près de 17 ans après avoir été commencé et deux ans avant la mort de Joyce. Finnegans Wake [texte imprimé] / James JOYCE . - 1982 . - 923.
ISBN : 978-2-07-040225-0
Langues : Français
Catégories : Écriture
Langage
Roman littéraire
SurréalismeMots-clés : Roman littéraire Surréalisme Langage Écriture Résumé : Traduit pour la première fois dans sa version intégrale, Finnegans Wake, ?uvre rebelle, s'exprime par épiphanies, telles que définies dans Ulysse - c'est-à-dire ces instants où les mots comme des photons reconstituent la figure d'interférence, visible seulement dans sa frange brillante. Pour certains, la révolution est à peine suffisante. Ils partent, hantent les asiles dont ils font une bibliothèque, habitent les prisons où flotte le feu de leurs rêves, créent un pseudo-langage qui n'est plus entendu mais reconnu de leurs seuls semblables. Errants jusqu'à l'inconsistance, telle la révolutionnaire russe Alexandra Kollontaï : " ... Comme j'aimais Kuusa en septembre... l'odeur des pins et, comme des toiles d'araignées tendues entre eux, les nuages chargés de rosée, au matin. " Réputé comme étant un texte difficile, voire illisible et intraduisible, Finnegans Wake est néanmoins considéré comme un monument de la littérature du XXe siècle. On dit ce livre " traduit de l'anglais " mais, en fait, il mêle plusieurs langues, à un tel point que certains spécialistes prétendent qu'il n'y a pas de langue de départ. Après avoir terminé Ulysse, Joyce pensait qu'il avait achevé l'?uvre de sa vie. Mais bientôt, il se remit au travail pour une ?uvre plus ambitieuse encore. Le 10 mars 1923, il commença un texte qu'il nomma d'abord Work in progress (Travail en cours) et plus tard Finnegans Wake. En 1926, il en avait déjà complété les deux premières parties. Cette année-là, il rencontra Eugène et Maria Jolas qui proposèrent de publier le livre en feuilleton dans leur magazine Transition. Les années suivantes, Joyce travailla rapidement sur ce nouveau livre, mais dans les années 1930, il progressa plus lentement. Cela était dû à plusieurs facteurs, dont la mort de son père en 1931, la santé mentale de sa fille Lucia Joyce et ses propres problèmes de santé, dont une vue qui déclinait. La majeure partie fut terminée avec l'assistance de jeunes admirateurs, parmi lesquels Samuel Beckett. Pendant plusieurs années, Joyce nourrit le projet excentrique de demander à James Stephens de terminer l'écriture du livre, et ce, pour la simple raison que Stephens était né dans le même hôpital que lui exactement une semaine plus tard, et qu'il partageait à la fois le même prénom que lui, et que, de plus, son personnage de fiction (cela est un exemple des nombreuses superstitions de Joyce). Lors de son 57e anniversaire chez les Jolas, Joyce annonça le titre final de son livre et Finnegans Wake fut publié sous la forme d'un livre le 4 mai 1939, près de 17 ans après avoir été commencé et deux ans avant la mort de Joyce. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 6707 L-JOYC Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Folie et psychanalyse dans l'expérience surréaliste / COLLECTIF
Titre : Folie et psychanalyse dans l'expérience surréaliste Type de document : texte imprimé Auteurs : COLLECTIF ; Fabienne HULAK ; Alain JOUFFROY Année de publication : 1992 Importance : 207 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-87720-086-8 Langues : Français Catégories : Écriture
Littérature
Peinture
Psychanalyse
Psychiatrie
SurréalismeMots-clés : Surréalisme Littérature Écriture Peinture Psychanalyse Psychiatrie Résumé : SOMMAIRE : - Fabienne HULAK : Avant-propos - Alain JOUFFROY : Préface 1. LES MOTS FONT L'AMOUR / LES MOTS POURRISSENT : STYLE ET POSITION SUBJECTIVE - Christian VEREECKEN : Le surréalisme en question ou d'une certaine confusion du parlêtre et du mot - Jeanik HUBERT : Du réel à l'ailleurs. Les vicissitudes du style dans les années 20 - Paul THEVENIN : L'automatisme en question 2. LE RONDEAU, LA CORDE ET LE PHAL MOU : LE SUJET DIVISE - Fabienne HULAK : Lambeaux maudits d'une phrase absurde - Pierre VERMEERSCH : Le retour à la ligne. Du dessin automatique d'André Masson - Marie-Claire DUMAS : Notes sur Robert Desnos 3. DE SAINT DIZIER AU CAHIER DE LA GIRAFE... ET LE SUJET DE LA SCIENCE - Marguerite BONNET : La rencontre d'André Breton avec la folie. Saint-Dizier, août-novembre 1916 - Etienne-Alain HUBERT : Autour d'un carnet d'André Breton (1920-1921). Ecriture automatique et psychanalyse - Marguerite BONNET : Note préliminaire au "Cahier de la girafe" - André BRETON : "Le cahier de la girafe" (inédit) - Marguerite BONNET : Nadja dans "la maison de verre" - Alain RAUZY : Sur l'immaculée conception en 1930 - Jean-Claude MALEVAL : De la contribution latérale. Lacan et le surréalisme - Table des illustrations Voir aussi : - Breton, Dali et Lacan, Claude LEGER, in : Barca !, n°5, 1995, p. 77-90. Folie et psychanalyse dans l'expérience surréaliste [texte imprimé] / COLLECTIF ; Fabienne HULAK ; Alain JOUFFROY . - 1992 . - 207 p.
ISBN : 978-2-87720-086-8
Langues : Français
Catégories : Écriture
Littérature
Peinture
Psychanalyse
Psychiatrie
SurréalismeMots-clés : Surréalisme Littérature Écriture Peinture Psychanalyse Psychiatrie Résumé : SOMMAIRE : - Fabienne HULAK : Avant-propos - Alain JOUFFROY : Préface 1. LES MOTS FONT L'AMOUR / LES MOTS POURRISSENT : STYLE ET POSITION SUBJECTIVE - Christian VEREECKEN : Le surréalisme en question ou d'une certaine confusion du parlêtre et du mot - Jeanik HUBERT : Du réel à l'ailleurs. Les vicissitudes du style dans les années 20 - Paul THEVENIN : L'automatisme en question 2. LE RONDEAU, LA CORDE ET LE PHAL MOU : LE SUJET DIVISE - Fabienne HULAK : Lambeaux maudits d'une phrase absurde - Pierre VERMEERSCH : Le retour à la ligne. Du dessin automatique d'André Masson - Marie-Claire DUMAS : Notes sur Robert Desnos 3. DE SAINT DIZIER AU CAHIER DE LA GIRAFE... ET LE SUJET DE LA SCIENCE - Marguerite BONNET : La rencontre d'André Breton avec la folie. Saint-Dizier, août-novembre 1916 - Etienne-Alain HUBERT : Autour d'un carnet d'André Breton (1920-1921). Ecriture automatique et psychanalyse - Marguerite BONNET : Note préliminaire au "Cahier de la girafe" - André BRETON : "Le cahier de la girafe" (inédit) - Marguerite BONNET : Nadja dans "la maison de verre" - Alain RAUZY : Sur l'immaculée conception en 1930 - Jean-Claude MALEVAL : De la contribution latérale. Lacan et le surréalisme - Table des illustrations Voir aussi : - Breton, Dali et Lacan, Claude LEGER, in : Barca !, n°5, 1995, p. 77-90. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 2876 GF-FOLI Livres Le Fil d'Ariane Grands Formats Disponible La Lettre et l'oeuvre dans la psychose / Fabienne HULAK
Titre : La Lettre et l'oeuvre dans la psychose Type de document : texte imprimé Auteurs : Fabienne HULAK ; Pierre VERMEERSCH Année de publication : 2006 Importance : 185 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7492-0580-9 Langues : Français Catégories : Automatisme mental
Écriture
hallucination
Langage
Psychose
Schizophrénie
SurréalismeMots-clés : Psychose Schizophrénie Hallucination Langage Écriture Automatisme mental Surréalisme Résumé : L'auteur s'attache à étudier les phénomènes de création permettant aux sujets psychotiques un arrimage pacifié à l'Autre. Elle dresse une généalogie de la fonction de la lettre, en amont d'une part, au coeur de la psychiatrie classique et à travers les concepts historiques tels que phénomène élémentaire, délire, stéréotypie, et en aval d'autre part, à partir de l'analyse de la fonction de l'oeuvre comme restauraton du lien social. Prendre en compte cette fonction littérale dans le cadre d'une relation transférentielle offre en effet des perspectives thérapeutiques intéressantes. TABLE DES MATIERES : 1) L'OEUVRE EN QUESTION DANS LA PSYCHOSE 2) LE SUJET EN QUESTION 3) LA DIVISION DU SUJET A CIEL OUVERT 4) LE SUJET INHERENT A SON HALLUCINATION 5) ANDRE BRETON ET ANTONIN ARTAUD : L'AUTOMATISME EN QUESTION 6) L'OEUVRE COMME SYMPTOME 7) AU-DELA DE LA PHENOMENOLOGIE DU SYMPTOME : DE LA LETTRE A LA STRUCTURE 8) POSTFACE : L'ENVERS DE LA CHOSE QUI N'EN A PAS La Lettre et l'oeuvre dans la psychose [texte imprimé] / Fabienne HULAK ; Pierre VERMEERSCH . - 2006 . - 185 p.
ISBN : 978-2-7492-0580-9
Langues : Français
Catégories : Automatisme mental
Écriture
hallucination
Langage
Psychose
Schizophrénie
SurréalismeMots-clés : Psychose Schizophrénie Hallucination Langage Écriture Automatisme mental Surréalisme Résumé : L'auteur s'attache à étudier les phénomènes de création permettant aux sujets psychotiques un arrimage pacifié à l'Autre. Elle dresse une généalogie de la fonction de la lettre, en amont d'une part, au coeur de la psychiatrie classique et à travers les concepts historiques tels que phénomène élémentaire, délire, stéréotypie, et en aval d'autre part, à partir de l'analyse de la fonction de l'oeuvre comme restauraton du lien social. Prendre en compte cette fonction littérale dans le cadre d'une relation transférentielle offre en effet des perspectives thérapeutiques intéressantes. TABLE DES MATIERES : 1) L'OEUVRE EN QUESTION DANS LA PSYCHOSE 2) LE SUJET EN QUESTION 3) LA DIVISION DU SUJET A CIEL OUVERT 4) LE SUJET INHERENT A SON HALLUCINATION 5) ANDRE BRETON ET ANTONIN ARTAUD : L'AUTOMATISME EN QUESTION 6) L'OEUVRE COMME SYMPTOME 7) AU-DELA DE LA PHENOMENOLOGIE DU SYMPTOME : DE LA LETTRE A LA STRUCTURE 8) POSTFACE : L'ENVERS DE LA CHOSE QUI N'EN A PAS Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 5310 L-HULA Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Lucien bonnafé, psychiatre désaliéniste / COLLECTIF
Titre : Lucien bonnafé, psychiatre désaliéniste Type de document : texte imprimé Auteurs : COLLECTIF ; Bernadette CHEVILLION Année de publication : 2005 Importance : 177 ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7475-7995-7 Langues : Français Catégories : aliénation
histoire
Hospitalisation
Psychanalyse
Psychiatrie
Psychiatrie alternative
Psychologie
Surréalisme
témoignageMots-clés : Histoire Psychiatrie Psychologie Psychanalyse Témoignage Aliénation Hospitalisation Surréalisme Psychiatrie alternative Résumé : Textes rassemblés par Bernadette Chevillion Bernadette Chevillion psychologue à Corbeil "Quand Bonnafé parlait des surréalistes, je me disais que j'étais avec celui qui avait vu Man Ray et discuté avec Crevel, des gens que je portais très haut. Mais la question de "changer le regard sur la folie", je ne l'ai comprise que plus tard. En revanche, on n'a jamais eu ici de regard pathologique sur les productions. On travaille avec des artistes qui ont un autre regard sur les patients. On n'a jamais été dans le courant de l'Art-thérapie, et c'est lié à ce que nous a appris Bonnafé du regard que les surréalistes portaient sur les oeuvres des patients. Tenter de changer le regard sur la maladie mentale, la folie, le handicap par des manifestations artistiques, c'est une dimension qui était présente dans les statuts d'Arrimages quand on l'a crée en 1992. Bonnafé m'a transmis son amour de la folie. Ce n'est pas bien d'être fasciné par les délires de l'autre. Malheureusement, ça m'arrive souvent. Je trouve les fous plus intéressants que les soignants. Je n'ai pas suivi Bonnafé sur le terrain de la poésie. Je suis partie du côté de la peinture, de la musique et du théâtre. Quiconque a essayé d'interviewer Bonnafé sait qu'il allait où il voulait, nous entraînait ailleurs. Parfois, c'était agréable, et d'autre fois, énervant. On avait par moment l'impression qu'il ne nous écoutait pas. En tous cas, il m'a cultivé. C'est sûr." Pratiques de la folie BIOGRAPHIE, AUTOBIOGRAPHIE, TÉMOIGNAGE, RÉCIT PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE Lucien Bonnafé est mort le 16 mars 2003. Ceux qui ont partagé son aventure ont tenté sur le vif de dire les chemins qu'il a ouverts. Folie, psychiatrie, poésie, politique, dans chacune de ces voies, Lucien Bonnafé a posé des paroles et des actes, comme autant d'invitations à poursuivre, chacun selon son style propre. Ce livre rassemble les textes de quelques-uns de ceux avec qui il a fait l'histoire et de quelques autres qui s'efforcent de la prolonger. Ce livre évoque une oeuvre pionnière, qui a marqué l'horizon des pratiques de la folie, dont la méthode et l'éthique se soutiennent d'un concept original : le désaliénisme. Bonnafé Lucien Né le 15 octobre 1912 à Figeac (Lot) dans une famille de médecins. Dans son enfance, le grand-père aliéniste, Maxime Dubuisson, " tient une place éminente dans le cortège des modèles identificatoires, il ne cessait de prononcer l'éloge de la folie et notre demeure était un musée où était rassemblée l'?uvre de la folie " : " Je me dois d'attester que si je suis ce que je suis, c'est pour beaucoup à l'?uvre des fous et des folles que je le dois. Mes jouets d'enfant étaient surtout cadeaux de leur part [...] C'est probablement à cette heure que j'ai appris à ne pas traiter les productions des fous dont ma vie a été jonchée comme objets de regard pathologiste. " Études au collège Champolion à Figeac puis études de médecine à Toulouse où il rencontre la " mouvance surréaliste " qui marquera sa vie tant professionnelle que politique. Compagnon de route du PCF, responsable de l'Union fédérale des étudiants et animateur d'un ciné-club, il adhère à la Jeunesse communiste en octobre 1934 après avoir été condamné pour opposition à une manifestation fasciste. 1936 voit l'achèvement de ses études de médecine et le début de son activité professionnelle en psychiatrie (il intègre les Hôpitaux psychiatriques de la Seine en 1938). Pendant la guerre d'Espagne, il milite à la Centrale sanitaire internationale. Mobilisé en 1939, il fait la guerre comme infirmier de 2e classe après avoir été cassé de son rang d'élève officier au motif d'avoir, avec Jean Marcenac, " empêché l'audition d'un discours du président du Conseil ". Après 1940, il participe aux premières rencontres de médecins communistes chez Marcel Pénin à Cachan au cours desquelles fut envisagée, notamment avec le docteur Maurice Ténine, la poursuite du combat antifasciste. Membre de la direction nationale du Front national des médecins en 1941, il participe, en 1942, au premier essai de service médical au cours d'une opération de résistance. Fin 1942, il est promu chef de service. En 1943, il est médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère. Il y poursuit son activité de résistant. Parallèlement, il anime la Société du Gévaudan qui veut définir le travail de critique radicale et d'invention des institutions d'aliénés, fait par l'équipe de l'hôpital de Saint-Alban, à laquelle se joint Georges Canguilhem. En 1942, il accueille dans cet hôpital Paul Éluard et multiplie les rencontres pour le développement de la résistance intellectuelle. Il est parmi les premiers diffuseurs de Poésie et vérité 1942 d'Éluard et contribue à l'importante activité d'éditions clandestines menée par celui-ci, avec la " Bibliothèque française " créée avec les frères Matarasso, chez Amarger, imprimeur à Saint-Flour. C'est à Saint-Alban qu'un certain Forestier est interné depuis 1914. Ses liens avec Dubuffet feront de son ?uvre un moment fort l'art brut. Forestier est familier à Lucien Bonnafé puisque " parmi les dessins fascinant peuplant le regard de l'enfance, il y avait l'autoportrait aux crayons de couleurs de Forestier le 20 juin 1914 et divers dessins de lui, où dominaient des têtes couronnées de mystérieux couvre-chef ornementés... ". Quand il quitte Saint-Alban pour la vie clandestine, Lucien Bonnafé choisit comme " nom de guerre " Sylvain Forestier. Cette rencontre avec l'?uvre de la folie lui fera dire : " Qui se voue à une tâche nommée désaliéniste [...] est voué à s'animer sur un champ de réflexion exceptionnellement révélateur : le fou producteur d'?uvre et ses témoins ". En 1944, membre du service médical du maquis lors de la bataille du Mont Mouchet, il est promu en juin président à Lyon du Comité national des médecins français (Front national zone sud) et participe aux combats de la Libération. Après la guerre, Lucien Bonnafé ne cesse de militer et de dénoncer la mort des 40 000 malades mentaux, victimes de l'extermination " douce " sous l'Occupation parmi lesquels Séraphine de Senlis et Sylvain Fusco. Conseiller technique au ministère de la santé dirigé par François Billoux en 1945, il organise les " Journées psychiatriques nationales " pour promouvoir la notion de désaliénisme et de pratique désenclavée. Il consacre alors sa longue carrière psychiatrique à la recherche d'un désaliénisme théorique et pratique. En mars 1946 est présentée à l'hôpital Saint-Anne une grande " exposition d'?uvres exécutées par des malades mentaux ". Accompagné de Robert Doisneau, Lucien Bonnafé publie une page polémique dans Action, hebdomadaire issu de la Résistance. Lucien Bonnafé y signe son premier papier de presse sur " art et folie " (" Des hommes comme vous ") : " Il y avait un grand remue-ménage des idées et des actes en France d'après Libération [...] Il soufflait un grand vent de protestation contre l'inhumanité du sort fait à la folie dans nos sociétés ". Bonnafé reprend son activité de praticien en 1947 et se consacre à l'organisation de la " psychiatrie de secteur ". Pour travailler à nouveau sur le terrain, il choisit un établissement en ruine, Sotteville-les-Rouen. Il y reste de 1947 à 1958. Il a choisi un lieu où tout est à reconstruire, l'hôpital est détruit à 75 %. Le mur qui sépare le quartier des femmes de celui des hommes est cassé, il ne sera jamais reconstruit. Il transforme les cellules en bureaux et, en 1951 (" pour donner du sens à une structure orientée vers l'aide aux sujets humains en difficulté, l'usage de la parole écrite était à cultiver "), il a recours au journal mural : " Au mur sur une planche étaient épinglés des textes ". Lucien Bonnafé a gardé les traces de ce passé (un recueil de pages de ce journal mural a été édité par l'Atelier du Coin de Montceau-les-Mines). Il continue ensuite sa carrière à Paris et en région parisienne où il prend sa retraite en 1973 après avoir fondé " Les Mozards ", secteur de psychiatrie à Corbeil-Essonnes. La désaliénation dans les systèmes de santé mentale est, à ses yeux, la nécessaire résistance aux conduites de partition, d'exclusion, de discrimination et de ségrégation, résistance à laquelle il a consacré sa vie. Privilégiant les problèmes de l'enfance, il est l'auteur de nombreux travaux de recherche sur le cadre de vie, la formation et la déformation des mentalités (notamment en participant au travail animé par Henri Lefebvre dans le Groupe de Navarrenx). Son activité politique proprement dite n'est pas séparable de sa démarche professionnelle et elle est dominée par la question des libertés et, selon ses propres termes, " la résistance aux perversions cléricales du mouvement révolutionnaire ". Il anime, en 1975, un débat à la Fête de L'Humanité pour dénoncer les usages répressifs de la psychiatrie dans les pays dits " socialistes " et persiste, toujours selon ses propres termes, " dans une position de résistance, dans le PCF, aux obligations et interdictions de penser (par exemple à l'égard de la psychanalyse) et aux insuffisances de critiques sur le "marxisme de chapitres de chanoines" et le "militantisme de sérail" ". Lucien Bonnafé n'a pas cessé de relier ses engagements psychiatriques théoriques et pratiques avec un intérêt pour la linguistique et les pratiques artistiques, la poésie, le combat politique, de la Résistance aux interrogations sur la citoyenneté. Une vie de résistance et d'invention. Lucien Bonnafé est décédé le 16 mars 2003 Lucien bonnafé, psychiatre désaliéniste [texte imprimé] / COLLECTIF ; Bernadette CHEVILLION . - 2005 . - 177.
ISBN : 978-2-7475-7995-7
Langues : Français
Catégories : aliénation
histoire
Hospitalisation
Psychanalyse
Psychiatrie
Psychiatrie alternative
Psychologie
Surréalisme
témoignageMots-clés : Histoire Psychiatrie Psychologie Psychanalyse Témoignage Aliénation Hospitalisation Surréalisme Psychiatrie alternative Résumé : Textes rassemblés par Bernadette Chevillion Bernadette Chevillion psychologue à Corbeil "Quand Bonnafé parlait des surréalistes, je me disais que j'étais avec celui qui avait vu Man Ray et discuté avec Crevel, des gens que je portais très haut. Mais la question de "changer le regard sur la folie", je ne l'ai comprise que plus tard. En revanche, on n'a jamais eu ici de regard pathologique sur les productions. On travaille avec des artistes qui ont un autre regard sur les patients. On n'a jamais été dans le courant de l'Art-thérapie, et c'est lié à ce que nous a appris Bonnafé du regard que les surréalistes portaient sur les oeuvres des patients. Tenter de changer le regard sur la maladie mentale, la folie, le handicap par des manifestations artistiques, c'est une dimension qui était présente dans les statuts d'Arrimages quand on l'a crée en 1992. Bonnafé m'a transmis son amour de la folie. Ce n'est pas bien d'être fasciné par les délires de l'autre. Malheureusement, ça m'arrive souvent. Je trouve les fous plus intéressants que les soignants. Je n'ai pas suivi Bonnafé sur le terrain de la poésie. Je suis partie du côté de la peinture, de la musique et du théâtre. Quiconque a essayé d'interviewer Bonnafé sait qu'il allait où il voulait, nous entraînait ailleurs. Parfois, c'était agréable, et d'autre fois, énervant. On avait par moment l'impression qu'il ne nous écoutait pas. En tous cas, il m'a cultivé. C'est sûr." Pratiques de la folie BIOGRAPHIE, AUTOBIOGRAPHIE, TÉMOIGNAGE, RÉCIT PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE Lucien Bonnafé est mort le 16 mars 2003. Ceux qui ont partagé son aventure ont tenté sur le vif de dire les chemins qu'il a ouverts. Folie, psychiatrie, poésie, politique, dans chacune de ces voies, Lucien Bonnafé a posé des paroles et des actes, comme autant d'invitations à poursuivre, chacun selon son style propre. Ce livre rassemble les textes de quelques-uns de ceux avec qui il a fait l'histoire et de quelques autres qui s'efforcent de la prolonger. Ce livre évoque une oeuvre pionnière, qui a marqué l'horizon des pratiques de la folie, dont la méthode et l'éthique se soutiennent d'un concept original : le désaliénisme. Bonnafé Lucien Né le 15 octobre 1912 à Figeac (Lot) dans une famille de médecins. Dans son enfance, le grand-père aliéniste, Maxime Dubuisson, " tient une place éminente dans le cortège des modèles identificatoires, il ne cessait de prononcer l'éloge de la folie et notre demeure était un musée où était rassemblée l'?uvre de la folie " : " Je me dois d'attester que si je suis ce que je suis, c'est pour beaucoup à l'?uvre des fous et des folles que je le dois. Mes jouets d'enfant étaient surtout cadeaux de leur part [...] C'est probablement à cette heure que j'ai appris à ne pas traiter les productions des fous dont ma vie a été jonchée comme objets de regard pathologiste. " Études au collège Champolion à Figeac puis études de médecine à Toulouse où il rencontre la " mouvance surréaliste " qui marquera sa vie tant professionnelle que politique. Compagnon de route du PCF, responsable de l'Union fédérale des étudiants et animateur d'un ciné-club, il adhère à la Jeunesse communiste en octobre 1934 après avoir été condamné pour opposition à une manifestation fasciste. 1936 voit l'achèvement de ses études de médecine et le début de son activité professionnelle en psychiatrie (il intègre les Hôpitaux psychiatriques de la Seine en 1938). Pendant la guerre d'Espagne, il milite à la Centrale sanitaire internationale. Mobilisé en 1939, il fait la guerre comme infirmier de 2e classe après avoir été cassé de son rang d'élève officier au motif d'avoir, avec Jean Marcenac, " empêché l'audition d'un discours du président du Conseil ". Après 1940, il participe aux premières rencontres de médecins communistes chez Marcel Pénin à Cachan au cours desquelles fut envisagée, notamment avec le docteur Maurice Ténine, la poursuite du combat antifasciste. Membre de la direction nationale du Front national des médecins en 1941, il participe, en 1942, au premier essai de service médical au cours d'une opération de résistance. Fin 1942, il est promu chef de service. En 1943, il est médecin-directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban en Lozère. Il y poursuit son activité de résistant. Parallèlement, il anime la Société du Gévaudan qui veut définir le travail de critique radicale et d'invention des institutions d'aliénés, fait par l'équipe de l'hôpital de Saint-Alban, à laquelle se joint Georges Canguilhem. En 1942, il accueille dans cet hôpital Paul Éluard et multiplie les rencontres pour le développement de la résistance intellectuelle. Il est parmi les premiers diffuseurs de Poésie et vérité 1942 d'Éluard et contribue à l'importante activité d'éditions clandestines menée par celui-ci, avec la " Bibliothèque française " créée avec les frères Matarasso, chez Amarger, imprimeur à Saint-Flour. C'est à Saint-Alban qu'un certain Forestier est interné depuis 1914. Ses liens avec Dubuffet feront de son ?uvre un moment fort l'art brut. Forestier est familier à Lucien Bonnafé puisque " parmi les dessins fascinant peuplant le regard de l'enfance, il y avait l'autoportrait aux crayons de couleurs de Forestier le 20 juin 1914 et divers dessins de lui, où dominaient des têtes couronnées de mystérieux couvre-chef ornementés... ". Quand il quitte Saint-Alban pour la vie clandestine, Lucien Bonnafé choisit comme " nom de guerre " Sylvain Forestier. Cette rencontre avec l'?uvre de la folie lui fera dire : " Qui se voue à une tâche nommée désaliéniste [...] est voué à s'animer sur un champ de réflexion exceptionnellement révélateur : le fou producteur d'?uvre et ses témoins ". En 1944, membre du service médical du maquis lors de la bataille du Mont Mouchet, il est promu en juin président à Lyon du Comité national des médecins français (Front national zone sud) et participe aux combats de la Libération. Après la guerre, Lucien Bonnafé ne cesse de militer et de dénoncer la mort des 40 000 malades mentaux, victimes de l'extermination " douce " sous l'Occupation parmi lesquels Séraphine de Senlis et Sylvain Fusco. Conseiller technique au ministère de la santé dirigé par François Billoux en 1945, il organise les " Journées psychiatriques nationales " pour promouvoir la notion de désaliénisme et de pratique désenclavée. Il consacre alors sa longue carrière psychiatrique à la recherche d'un désaliénisme théorique et pratique. En mars 1946 est présentée à l'hôpital Saint-Anne une grande " exposition d'?uvres exécutées par des malades mentaux ". Accompagné de Robert Doisneau, Lucien Bonnafé publie une page polémique dans Action, hebdomadaire issu de la Résistance. Lucien Bonnafé y signe son premier papier de presse sur " art et folie " (" Des hommes comme vous ") : " Il y avait un grand remue-ménage des idées et des actes en France d'après Libération [...] Il soufflait un grand vent de protestation contre l'inhumanité du sort fait à la folie dans nos sociétés ". Bonnafé reprend son activité de praticien en 1947 et se consacre à l'organisation de la " psychiatrie de secteur ". Pour travailler à nouveau sur le terrain, il choisit un établissement en ruine, Sotteville-les-Rouen. Il y reste de 1947 à 1958. Il a choisi un lieu où tout est à reconstruire, l'hôpital est détruit à 75 %. Le mur qui sépare le quartier des femmes de celui des hommes est cassé, il ne sera jamais reconstruit. Il transforme les cellules en bureaux et, en 1951 (" pour donner du sens à une structure orientée vers l'aide aux sujets humains en difficulté, l'usage de la parole écrite était à cultiver "), il a recours au journal mural : " Au mur sur une planche étaient épinglés des textes ". Lucien Bonnafé a gardé les traces de ce passé (un recueil de pages de ce journal mural a été édité par l'Atelier du Coin de Montceau-les-Mines). Il continue ensuite sa carrière à Paris et en région parisienne où il prend sa retraite en 1973 après avoir fondé " Les Mozards ", secteur de psychiatrie à Corbeil-Essonnes. La désaliénation dans les systèmes de santé mentale est, à ses yeux, la nécessaire résistance aux conduites de partition, d'exclusion, de discrimination et de ségrégation, résistance à laquelle il a consacré sa vie. Privilégiant les problèmes de l'enfance, il est l'auteur de nombreux travaux de recherche sur le cadre de vie, la formation et la déformation des mentalités (notamment en participant au travail animé par Henri Lefebvre dans le Groupe de Navarrenx). Son activité politique proprement dite n'est pas séparable de sa démarche professionnelle et elle est dominée par la question des libertés et, selon ses propres termes, " la résistance aux perversions cléricales du mouvement révolutionnaire ". Il anime, en 1975, un débat à la Fête de L'Humanité pour dénoncer les usages répressifs de la psychiatrie dans les pays dits " socialistes " et persiste, toujours selon ses propres termes, " dans une position de résistance, dans le PCF, aux obligations et interdictions de penser (par exemple à l'égard de la psychanalyse) et aux insuffisances de critiques sur le "marxisme de chapitres de chanoines" et le "militantisme de sérail" ". Lucien Bonnafé n'a pas cessé de relier ses engagements psychiatriques théoriques et pratiques avec un intérêt pour la linguistique et les pratiques artistiques, la poésie, le combat politique, de la Résistance aux interrogations sur la citoyenneté. Une vie de résistance et d'invention. Lucien Bonnafé est décédé le 16 mars 2003 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 6439 L-BONN Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Unica Zürn et L'Homme Jasmin (le dit-schizophrène) / Jean-Claude MARCEAU
Titre : Unica Zürn et L'Homme Jasmin (le dit-schizophrène) Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude MARCEAU ; Henri BEHAR Année de publication : 2005 Importance : 204 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7475-9567-4 Langues : Français Catégories : Altérité
Corps
Écriture
Fétichisme
Forclusion du Nom-du-Père
hallucination
Image spéculaire
Jouissance
Langage
Perversion
Phallus
Psychose
RSI
Schizophrénie
SurréalismeMots-clés : Schizophrénie Psychose Corps Langage Écriture Jouissance Phallus Altérité Forclusion du Nom-du-Père RSI Image spéculaire Hallucination Perversion Fétichisme Surréalisme Résumé : Unica Zürn fut l'une des égéries du mouvement surréaliste. Compagne de Hans Bellmer, cette artiste souffrait de schizophrénie et connut une fin tragique en se défenestrant. Dans ses récits autobiographiques, elle nous livre une belle leçon sur l'amour et la psychose. Ce dit-schizophrène, l'histoire de L'Homme Jasmin, se trouve ici retracé à la lumière de la psychanalyse lacanienne. Détour est fait par l'oeuvre de Bellmer, pour mieux saisir comment celui-ci apparaît comme le partenaire-symptôme d'Unica. Joyce et Schreber sont évoqués afin d'illustrer la jouissance psychotique. Voir aussi : - Dossier Unica Zurn, in : Transitions (Revue de l'innovation psychiatrique et sociale), n°8, 1981, p.15-78. - Jean BROUSTRA : Unica Zürn : les confidences de la folie (De "Sombre Printemps" à "L'Homme-Jasmin", in : L'information psychiatrique, 75/2, février 1999, 151-160. Unica Zürn et L'Homme Jasmin (le dit-schizophrène) [texte imprimé] / Jean-Claude MARCEAU ; Henri BEHAR . - 2005 . - 204 p.
ISBN : 978-2-7475-9567-4
Langues : Français
Catégories : Altérité
Corps
Écriture
Fétichisme
Forclusion du Nom-du-Père
hallucination
Image spéculaire
Jouissance
Langage
Perversion
Phallus
Psychose
RSI
Schizophrénie
SurréalismeMots-clés : Schizophrénie Psychose Corps Langage Écriture Jouissance Phallus Altérité Forclusion du Nom-du-Père RSI Image spéculaire Hallucination Perversion Fétichisme Surréalisme Résumé : Unica Zürn fut l'une des égéries du mouvement surréaliste. Compagne de Hans Bellmer, cette artiste souffrait de schizophrénie et connut une fin tragique en se défenestrant. Dans ses récits autobiographiques, elle nous livre une belle leçon sur l'amour et la psychose. Ce dit-schizophrène, l'histoire de L'Homme Jasmin, se trouve ici retracé à la lumière de la psychanalyse lacanienne. Détour est fait par l'oeuvre de Bellmer, pour mieux saisir comment celui-ci apparaît comme le partenaire-symptôme d'Unica. Joyce et Schreber sont évoqués afin d'illustrer la jouissance psychotique. Voir aussi : - Dossier Unica Zurn, in : Transitions (Revue de l'innovation psychiatrique et sociale), n°8, 1981, p.15-78. - Jean BROUSTRA : Unica Zürn : les confidences de la folie (De "Sombre Printemps" à "L'Homme-Jasmin", in : L'information psychiatrique, 75/2, février 1999, 151-160. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 5392 L-MARC Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible