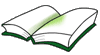Le Fil d’Ariane
Centre de documentation spécialisé en santé mentale
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheCe que parler veut dire / Pierre BOURDIEU
Titre : Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre BOURDIEU Editeur : Paris : Fayard Année de publication : 1982. Importance : 243 p. Présentation : ill. Format : 22 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-213-01216-2 Note générale : Recueil de textes remaniés, extraits pour la plupart de "Actes de la recherche en sciences sociales", 1975-1981. Langues : Français Catégories : Discours
Économie
Langage
Nationalisme
Politique
Sociologie
SymboliqueRésumé : Le discours n'est pas seulement un message destiné à être déchiffré; c'est aussi un produit que nous livrons à l'appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec d'autres produits plus rares ou plus communs. L'effet du marché linguistique, qui se rappelle à la conscience dans la timidité ou dans le trac des prises de parole publiques, ne cesse pas de s'exercer jusque dans les échanges les plus ordinaires de l'existence quotidienne: témoins les changements de langue que, dans les situations de bilinguisme, sans même y penser, les locuteurs opèrent en fonction des caractéristiques sociales de leur interlocuteur; ou, plus simplement, les corrections que doivent faire subir à leur accent, dès qu'ils sont placés en situation officielle, ceux qui sont ou se sentent les plus éloignés de la langue légitime.Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse et un instrument du pouvoir. Et la science sociale doit essayer de rendre raison de ce qui est bien, si l'on y songe, un fait de magie: on peut agir avec des mots, ordres ou mots d'ordre. La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-parole? On se trouve ainsi affronté à ce que les scolastiques appelaient le mystère du ministère, miracle de la transsubstantiation qui investit la parole du porte-parole d'une force qu'elle tient du groupe même sur lequel elle l'exerce.Ayant ainsi renouvelé la manière de penser le langage, on peut aborder le terrain par excellence du pouvoir symbolique, celui de la politique, lieu de la prévision comme prédiction prétendant à produire sa propre réalisation. Et comprendre, dans leur économie spécifique, les luttes les plus éloignées, en apparence, de toute rationalité économique, comme celles du régionalisme ou du nationalisme. Mais on peut aussi, à titre de vérification, porter au jour l'intention refoulée de textes philosophiques dont la rigueur apparente n'est souvent que la trace visible de la censure particulièrement rigoureuse du marché auquel ils se destinent.P. B. Note de contenu : Bourdieu nous offre ici un bon exemple des résultats auxquels on peut arriver en faisant se croiser linguistique et sociologie. Abolissant la frontière entre linguistique interne et externe promulguée par Saussure, Bourdieu tente de nous décrire, par de multiples exemples, la langue comme indissociable des conditions sociales dans lesquelles elle est mise en fonctionnement. Les exemples sont de qualité avec la réserve que ce sociologue use parfois d'une langue qu'il faut se laisser le temps d'apprivoiser.
Un ouvrage central pour une perspective sociolinguistique de la part du plus regretté de nos sociologues.Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques [texte imprimé] / Pierre BOURDIEU . - Paris : Fayard, 1982. . - 243 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-213-01216-2
Recueil de textes remaniés, extraits pour la plupart de "Actes de la recherche en sciences sociales", 1975-1981.
Langues : Français
Catégories : Discours
Économie
Langage
Nationalisme
Politique
Sociologie
SymboliqueRésumé : Le discours n'est pas seulement un message destiné à être déchiffré; c'est aussi un produit que nous livrons à l'appréciation des autres et dont la valeur se définira dans sa relation avec d'autres produits plus rares ou plus communs. L'effet du marché linguistique, qui se rappelle à la conscience dans la timidité ou dans le trac des prises de parole publiques, ne cesse pas de s'exercer jusque dans les échanges les plus ordinaires de l'existence quotidienne: témoins les changements de langue que, dans les situations de bilinguisme, sans même y penser, les locuteurs opèrent en fonction des caractéristiques sociales de leur interlocuteur; ou, plus simplement, les corrections que doivent faire subir à leur accent, dès qu'ils sont placés en situation officielle, ceux qui sont ou se sentent les plus éloignés de la langue légitime.Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur de richesse et un instrument du pouvoir. Et la science sociale doit essayer de rendre raison de ce qui est bien, si l'on y songe, un fait de magie: on peut agir avec des mots, ordres ou mots d'ordre. La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-parole? On se trouve ainsi affronté à ce que les scolastiques appelaient le mystère du ministère, miracle de la transsubstantiation qui investit la parole du porte-parole d'une force qu'elle tient du groupe même sur lequel elle l'exerce.Ayant ainsi renouvelé la manière de penser le langage, on peut aborder le terrain par excellence du pouvoir symbolique, celui de la politique, lieu de la prévision comme prédiction prétendant à produire sa propre réalisation. Et comprendre, dans leur économie spécifique, les luttes les plus éloignées, en apparence, de toute rationalité économique, comme celles du régionalisme ou du nationalisme. Mais on peut aussi, à titre de vérification, porter au jour l'intention refoulée de textes philosophiques dont la rigueur apparente n'est souvent que la trace visible de la censure particulièrement rigoureuse du marché auquel ils se destinent.P. B. Note de contenu : Bourdieu nous offre ici un bon exemple des résultats auxquels on peut arriver en faisant se croiser linguistique et sociologie. Abolissant la frontière entre linguistique interne et externe promulguée par Saussure, Bourdieu tente de nous décrire, par de multiples exemples, la langue comme indissociable des conditions sociales dans lesquelles elle est mise en fonctionnement. Les exemples sont de qualité avec la réserve que ce sociologue use parfois d'une langue qu'il faut se laisser le temps d'apprivoiser.
Un ouvrage central pour une perspective sociolinguistique de la part du plus regretté de nos sociologues.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8487 L-BOUR Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Logiques de l'exclusion / Norbert ELIAS
Titre : Logiques de l'exclusion : enquête sociologique au coeur des problèmes d'une communauté Type de document : texte imprimé Auteurs : Norbert ELIAS, Auteur ; John L. Scotson, Auteur Editeur : Paris : Fayard Année de publication : impr. 1997, cop. 1997 Importance : 1 vol. (278 p.) Présentation : couv. ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-213-59955-6 Prix : 120 FRF Note générale : Logiques de l'exclusion
L'enquête sur les problèmes d'une cité de banlieue à la fin des années 1950 que présente ici Norbert Elias est d'une actualité surprenante car elle éclaire les débats les plus actuels sur l'exclusion. Elle met en effet au jour, de façon très concrète, le racisme sans race, l'exclusion sans fracture économique ainsi que toute une série de thèmes qui sont au coeur des préoccupations de nos sociétés contemporaines: le respect, la dignité,l'estime de soi.
Dans cette petite ville d'Angleterre, formée de lotissements successifs, les tensions sont multiples entre les habitants et les nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds comme des étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le sentiment qu'ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la vie courante, les écartent des lieux de décision, des associations de loisirs, des clubs et des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou trois générations, entretenu par les rumeurs et les commérages. Or nul racisme ici au sens propre, nulle menace de chômage à cette époque _ les uns et les autres sont des ouvriers ou des petits bourgeois et travaillent dans les mêmes usines. Ce refus de la relation à l'autre, explique Norbert Elias, est à replacer dans un contexte plus large de rapport de pouvoir: le groupe dominant reproduit sa domination _ et renforce sa cohésion _ en excluant les " marginaux ", cette image collective confortant à son tour l'image que chacun se fait de soi à l'intérieur du groupe. Ainsi, du côté des exclus, " ces jeunes qui, sachant qu'ils indisposaient ceux qui les traitaient en parias, trouvaient là une incitation supplémentaire, peut-être l'incitation majeure à se mal conduire ".Catégories : Exclusion
Marginalité
SDFLogiques de l'exclusion : enquête sociologique au coeur des problèmes d'une communauté [texte imprimé] / Norbert ELIAS, Auteur ; John L. Scotson, Auteur . - Paris : Fayard, impr. 1997, cop. 1997 . - 1 vol. (278 p.) : couv. ill. ; 22 cm.
ISBN : 2-213-59955-6 : 120 FRF
Logiques de l'exclusion
L'enquête sur les problèmes d'une cité de banlieue à la fin des années 1950 que présente ici Norbert Elias est d'une actualité surprenante car elle éclaire les débats les plus actuels sur l'exclusion. Elle met en effet au jour, de façon très concrète, le racisme sans race, l'exclusion sans fracture économique ainsi que toute une série de thèmes qui sont au coeur des préoccupations de nos sociétés contemporaines: le respect, la dignité,l'estime de soi.
Dans cette petite ville d'Angleterre, formée de lotissements successifs, les tensions sont multiples entre les habitants et les nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds comme des étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le sentiment qu'ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la vie courante, les écartent des lieux de décision, des associations de loisirs, des clubs et des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou trois générations, entretenu par les rumeurs et les commérages. Or nul racisme ici au sens propre, nulle menace de chômage à cette époque _ les uns et les autres sont des ouvriers ou des petits bourgeois et travaillent dans les mêmes usines. Ce refus de la relation à l'autre, explique Norbert Elias, est à replacer dans un contexte plus large de rapport de pouvoir: le groupe dominant reproduit sa domination _ et renforce sa cohésion _ en excluant les " marginaux ", cette image collective confortant à son tour l'image que chacun se fait de soi à l'intérieur du groupe. Ainsi, du côté des exclus, " ces jeunes qui, sachant qu'ils indisposaient ceux qui les traitaient en parias, trouvaient là une incitation supplémentaire, peut-être l'incitation majeure à se mal conduire ".
Catégories : Exclusion
Marginalité
SDFRéservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8345 L-ELIA Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible La société en réseaux, 1. L'ère de l'information / Manuel Castells
Titre de série : La société en réseaux, 1 Titre : L'ère de l'information Type de document : texte imprimé Auteurs : Manuel Castells (1942-....), Auteur ; Alain TOURAINE, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Fayard Année de publication : impr. 1998, cop. 1998, DL 1999 Collection : L'ère de l'information num. 1 Importance : 1 vol. (613 p.) Présentation : graph., tabl. couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-213-60041-3 Note générale : Trente ans après les premiers travaux de Daniel Bell et d'Alain Touraine sur la société postindustrielle, la traduction française de l'ouvrage de Manuel Castells, consacré à la «société en réseaux», est un événement. Dans ce premier volume d'un ensemble de trois, l'auteur définit les traits de la société de l'information dans laquelle nous entrons. Au-delà de la masse documentaire qu'il présente, un de ses principaux mérites est son souci de clarifier et de distinguer des niveaux d'analyses souvent confondus : quelles que soient les interactions qui se produisent, explique-t-il, la révolution des technologies de l'information est indépendante dans sa nature de la révolution néo-capitaliste. Castells nous invite également à différencier l'économie globale informationnelle, comme mode de développement, de la société informationnelle, comme mode de production, ou type sociétal.
Tout en refusant le déterminisme technologique, l'auteur prend pour point de départ les bouleversantes révolutions techniques de ces dernières décennies, dont il retrace les grandes étapes (invention du microprocesseur en 1971, premier gène humain cloné en 1977...), avant de mesurer leur pénétration au cœur des activités humaines.
Il dégage les éléments de la nouvelle économie informationnelle, dont la maîtrise de la connaissance est l'élément clef. Dans une seconde phase, il décrit les nouvelles logiques organisationnelles de «l'entreprise en réseaux», le passage du modèle hiérarchique vertical à celui du réseau horizontal, faisant la part des effets des technologies de l'information et de ce qui n'en relève pas. Il montre à quel point le travail est bouleversé par le paradigme informationnel (suppression des tâches routinières et valorisation de la coopération et de la créativité dans le travail), mais reste en dernier ressort subordonné à l'utilisation sociopolitique que nous en faisons. Enfin, dans une optique plus culturelle, il montre comment la logique des réseaux façonne un nouveau rapport au temps et à l'espace. Manuel Castells consacre des pages passionnantes à l'analyse des villes, dont il montre qu'à l'image de l'ensemble de la société, elles se scindent en deux univers étrangers : l'espace des flux, lié aux réseaux mondiaux, et l'espace des lieux, celui de l'expérience vécue. Deux autres volumes viendront compléter ce premier volet d'un ensemble qui, à n'en pas douter, fera date.
Catégories : Communication
Économie
Globalisation
Réseau
Temps
travail
VirtuelLa société en réseaux, 1. L'ère de l'information [texte imprimé] / Manuel Castells (1942-....), Auteur ; Alain TOURAINE, Préfacier, etc. . - Paris : Fayard, impr. 1998, cop. 1998, DL 1999 . - 1 vol. (613 p.) : graph., tabl. couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (L'ère de l'information; 1) .
ISBN : 978-2-213-60041-3
Trente ans après les premiers travaux de Daniel Bell et d'Alain Touraine sur la société postindustrielle, la traduction française de l'ouvrage de Manuel Castells, consacré à la «société en réseaux», est un événement. Dans ce premier volume d'un ensemble de trois, l'auteur définit les traits de la société de l'information dans laquelle nous entrons. Au-delà de la masse documentaire qu'il présente, un de ses principaux mérites est son souci de clarifier et de distinguer des niveaux d'analyses souvent confondus : quelles que soient les interactions qui se produisent, explique-t-il, la révolution des technologies de l'information est indépendante dans sa nature de la révolution néo-capitaliste. Castells nous invite également à différencier l'économie globale informationnelle, comme mode de développement, de la société informationnelle, comme mode de production, ou type sociétal.
Tout en refusant le déterminisme technologique, l'auteur prend pour point de départ les bouleversantes révolutions techniques de ces dernières décennies, dont il retrace les grandes étapes (invention du microprocesseur en 1971, premier gène humain cloné en 1977...), avant de mesurer leur pénétration au cœur des activités humaines.
Il dégage les éléments de la nouvelle économie informationnelle, dont la maîtrise de la connaissance est l'élément clef. Dans une seconde phase, il décrit les nouvelles logiques organisationnelles de «l'entreprise en réseaux», le passage du modèle hiérarchique vertical à celui du réseau horizontal, faisant la part des effets des technologies de l'information et de ce qui n'en relève pas. Il montre à quel point le travail est bouleversé par le paradigme informationnel (suppression des tâches routinières et valorisation de la coopération et de la créativité dans le travail), mais reste en dernier ressort subordonné à l'utilisation sociopolitique que nous en faisons. Enfin, dans une optique plus culturelle, il montre comment la logique des réseaux façonne un nouveau rapport au temps et à l'espace. Manuel Castells consacre des pages passionnantes à l'analyse des villes, dont il montre qu'à l'image de l'ensemble de la société, elles se scindent en deux univers étrangers : l'espace des flux, lié aux réseaux mondiaux, et l'espace des lieux, celui de l'expérience vécue. Deux autres volumes viendront compléter ce premier volet d'un ensemble qui, à n'en pas douter, fera date.
Catégories : Communication
Économie
Globalisation
Réseau
Temps
travail
VirtuelRéservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8369 L-CAST Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible