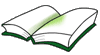| Titre : | Au-delà de Freud - Sociologie, psychologie, psychanalyse | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Norbert ELIAS | | Année de publication : | 2010 | | Importance : | 216 | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2707-15760797-8 | | Langues : | Français | | Catégories : | Civilisation
Dualisme
Freud
Horde primitive
Maladie psychosomatique
Psychologie
Sociologie
| | Mots-clés : | Maladie psychosomatique Civilisation Freud Sociologie Psychologie Dualisme Horde primitive | | Résumé : | Traduit par Nicolas Guilhot, Marc Joly et Valentine Meunier, postface de Bernard Lahire Norbert Elias, l'un des sociologues les plus importants du xxe siècle, est surtout connu pour son ouvrage sur le processus de civilisation (Über den Prozess der Zivilisation, 1939), traduit en français sous les titres La Civilisation des m?urs (1973) et La Dynamique de l'Occident (1975). Dans les cinq textes réunis dans le présent recueil, inédits en français, Elias se confronte à des problématiques liées à la psychologie au sens large. Qu'il s'agisse du domaine de la psychologie sociale, des rapports psychiatrie/sociologie, de la " civilisation " des relations entre parents et enfants ou de l'impact du processus de civilisation sur les maladies psychosomatiques, le sociologue parvient toujours à déployer son propre système de pensée et à clarifier des problèmes en apparence inextricables. Le dernier texte du volume est un peu à part. Il s'agit d'un manuscrit sur Sigmund Freud que la mort d'Elias laissa inachevé. Le texte n'en est pas moins profond et original. Elias y critique tout d'abord le dualisme freudien et le mythe du meurtre du père de la Horde primitive. Puis il montre que les caractéristiques répressives de la société sont toujours la conséquence d'une certaine configuration des relations de pouvoir entre groupes sociaux. Ce qui lui permet d'opérer un retour critique sur la théorie du processus de civilisation. Mais son propos ne s'arrête pas là, puisqu'il esquisse, de manière fascinante, une reconceptualisation d'ensemble des concepts de la psychanalyse à l'aune d'une remise en jeu de la frontière nature/culture. En somme, ce texte peut être considéré comme le testament intellectuel du plus freudien des sociologues. Le premier texte, "Le domaine de la psychologie sociale", est issu d?un cours d?introduction à la psychologie sociale donné en 1950 dans un institut de traitement de la délinquance ? à une époque où Elias, toujours en attente d?un poste universitaire après son exil en Angleterre, était très proche de Foulkes (exilé comme lui) et de ses expériences de psychothérapie de groupe. Il y définit l?objet de la psychologie sociale sous ses trois aspects de "comportement humain", d?"expérience humaine" et de "développement humain" : trois dimensions ayant en commun la prise en compte d?autrui, à la différence de la "psychologie générale", qui se donne pour objet "l?individu en tant que tel" ? une perspective erronée bien sûr puisque, selon Elias, "il n?existe pas d?individu isolé, et nous ne pouvons jamais accéder à la compréhension d?un être humain si ce n?est en observant la façon dont il se développe dans ses relations avec d?autres êtres humains". C?est dire que, dans cette perspective, toute psychologie devrait être une psychologie sociale, qui ne diffère que marginalement de la sociologie, laquelle met davantage l?accent sur le "cadre" dans lequel l?individu agit "plutôt que sur les processus qui affectent intérieurement l?individu". Le deuxième texte, "Sociologie et psychiatrie", est une conférence prononcée en 1965 ? toujours en anglais ? dans une "Association royale" médico-psychologique. Il y critique la tendance des psychiatres à adhérer spontanément à la conception de l?être humain comme "homo clausus", défini indépendamment des "structures familiales" et des "structures sociales", ainsi réduites à de simples "facteurs environnementaux". Cette conception ne diffère donc pas de la perception spontanée du sens commun, en vertu de laquelle "l?être humain fait l?expérience de lui-même comme le centre de toutes choses, tout le reste se trouvant en dehors de lui, séparé par un mur invisible", et "impute une expérience similaire à tous les autres individus". Ce n?est là toutefois qu?une conception propre à un certain type de sociétés ? les nôtres ? et qui, "selon toute probabilité, touche principalement les élites instruites". Contre cette illusion majeure, qu?Elias n?a cessé de combattre dans toute son ?uvre, il réaffirme qu?il n?existe pas d' "individu" sans "société", que ces deux entités ne sont pas des objets physiques distincts, et que seuls existent effectivement des "rapports d?interdépendance" à l?intérieur de "configurations de types variés". Dans cette perspective, une attention spéciale doit être apportée à ces configurations particulières que sont les "relations affectives", en tant qu?elles constituent un "pont entre la psychiatrie et la sociologie" ? au lieu que, pour Freud, il existait un "mur entre ce qui se passe à l?intérieur de l?être humain, en particulier ses représentations fantasmatiques affectives, qu?il explorait, et la réalité "externe", dans laquelle il ne s?aventurait pas". La prise au sérieux de cet entre-deux relationnel (et, notamment, des "interdépendances non intentionnelles" qui sous-tendent toutes les "interactions intentionnelles") incite également à considérer ? ce que Freud n?a pas fait ? que la libido n?est pas une pulsion en soi mais qu?elle est avant tout "dirigée d?un être humain vers un autre". Un tel point de vue met évidemment au premier plan la psychothérapie de groupe telle que la pratiquait, notamment, Foulkes. Le troisième texte, "La civilisation des parents", est une conférence grand public donnée à Berlin en 1980 en ouverture d?un colloque sur "Vivre avec des enfants". Sous une forme aisément accessible, Elias y relit les rapports parents-enfants à la lumière de sa thèse sur le "processus de civilisation", insistant notamment sur le "devenir-adulte" de l?enfant comme apprentissage de l?autocontrôle, et sur l?allongement de ce processus à mesure des progrès de la "civilisation des m?urs" ; sur les rapports de domination entre parents et enfants, qui tendent à s?atténuer à l?époque contemporaine (ce qui lui permet de critiquer au passage la vision "romantique" et idéalisante qu?avait Philippe Ariès de l?enfance dans l?ancien temps) ; et sur les transformations historiques de l?attachement aux enfants (beaucoup plus fort que par le passé, étant donné la maîtrise accrue du contrôle des naissances) ? l?amour parental étant un fait non pas "naturel" mais social. Ainsi peut-on comprendre le "durcissement de l?interdit de l?usage de la violence de la part des deux parties". |
Au-delà de Freud - Sociologie, psychologie, psychanalyse [texte imprimé] / Norbert ELIAS . - 2010 . - 216. ISSN : 978-2707-15760797-8 Langues : Français | Catégories : | Civilisation
Dualisme
Freud
Horde primitive
Maladie psychosomatique
Psychologie
Sociologie
| | Mots-clés : | Maladie psychosomatique Civilisation Freud Sociologie Psychologie Dualisme Horde primitive | | Résumé : | Traduit par Nicolas Guilhot, Marc Joly et Valentine Meunier, postface de Bernard Lahire Norbert Elias, l'un des sociologues les plus importants du xxe siècle, est surtout connu pour son ouvrage sur le processus de civilisation (Über den Prozess der Zivilisation, 1939), traduit en français sous les titres La Civilisation des m?urs (1973) et La Dynamique de l'Occident (1975). Dans les cinq textes réunis dans le présent recueil, inédits en français, Elias se confronte à des problématiques liées à la psychologie au sens large. Qu'il s'agisse du domaine de la psychologie sociale, des rapports psychiatrie/sociologie, de la " civilisation " des relations entre parents et enfants ou de l'impact du processus de civilisation sur les maladies psychosomatiques, le sociologue parvient toujours à déployer son propre système de pensée et à clarifier des problèmes en apparence inextricables. Le dernier texte du volume est un peu à part. Il s'agit d'un manuscrit sur Sigmund Freud que la mort d'Elias laissa inachevé. Le texte n'en est pas moins profond et original. Elias y critique tout d'abord le dualisme freudien et le mythe du meurtre du père de la Horde primitive. Puis il montre que les caractéristiques répressives de la société sont toujours la conséquence d'une certaine configuration des relations de pouvoir entre groupes sociaux. Ce qui lui permet d'opérer un retour critique sur la théorie du processus de civilisation. Mais son propos ne s'arrête pas là, puisqu'il esquisse, de manière fascinante, une reconceptualisation d'ensemble des concepts de la psychanalyse à l'aune d'une remise en jeu de la frontière nature/culture. En somme, ce texte peut être considéré comme le testament intellectuel du plus freudien des sociologues. Le premier texte, "Le domaine de la psychologie sociale", est issu d?un cours d?introduction à la psychologie sociale donné en 1950 dans un institut de traitement de la délinquance ? à une époque où Elias, toujours en attente d?un poste universitaire après son exil en Angleterre, était très proche de Foulkes (exilé comme lui) et de ses expériences de psychothérapie de groupe. Il y définit l?objet de la psychologie sociale sous ses trois aspects de "comportement humain", d?"expérience humaine" et de "développement humain" : trois dimensions ayant en commun la prise en compte d?autrui, à la différence de la "psychologie générale", qui se donne pour objet "l?individu en tant que tel" ? une perspective erronée bien sûr puisque, selon Elias, "il n?existe pas d?individu isolé, et nous ne pouvons jamais accéder à la compréhension d?un être humain si ce n?est en observant la façon dont il se développe dans ses relations avec d?autres êtres humains". C?est dire que, dans cette perspective, toute psychologie devrait être une psychologie sociale, qui ne diffère que marginalement de la sociologie, laquelle met davantage l?accent sur le "cadre" dans lequel l?individu agit "plutôt que sur les processus qui affectent intérieurement l?individu". Le deuxième texte, "Sociologie et psychiatrie", est une conférence prononcée en 1965 ? toujours en anglais ? dans une "Association royale" médico-psychologique. Il y critique la tendance des psychiatres à adhérer spontanément à la conception de l?être humain comme "homo clausus", défini indépendamment des "structures familiales" et des "structures sociales", ainsi réduites à de simples "facteurs environnementaux". Cette conception ne diffère donc pas de la perception spontanée du sens commun, en vertu de laquelle "l?être humain fait l?expérience de lui-même comme le centre de toutes choses, tout le reste se trouvant en dehors de lui, séparé par un mur invisible", et "impute une expérience similaire à tous les autres individus". Ce n?est là toutefois qu?une conception propre à un certain type de sociétés ? les nôtres ? et qui, "selon toute probabilité, touche principalement les élites instruites". Contre cette illusion majeure, qu?Elias n?a cessé de combattre dans toute son ?uvre, il réaffirme qu?il n?existe pas d' "individu" sans "société", que ces deux entités ne sont pas des objets physiques distincts, et que seuls existent effectivement des "rapports d?interdépendance" à l?intérieur de "configurations de types variés". Dans cette perspective, une attention spéciale doit être apportée à ces configurations particulières que sont les "relations affectives", en tant qu?elles constituent un "pont entre la psychiatrie et la sociologie" ? au lieu que, pour Freud, il existait un "mur entre ce qui se passe à l?intérieur de l?être humain, en particulier ses représentations fantasmatiques affectives, qu?il explorait, et la réalité "externe", dans laquelle il ne s?aventurait pas". La prise au sérieux de cet entre-deux relationnel (et, notamment, des "interdépendances non intentionnelles" qui sous-tendent toutes les "interactions intentionnelles") incite également à considérer ? ce que Freud n?a pas fait ? que la libido n?est pas une pulsion en soi mais qu?elle est avant tout "dirigée d?un être humain vers un autre". Un tel point de vue met évidemment au premier plan la psychothérapie de groupe telle que la pratiquait, notamment, Foulkes. Le troisième texte, "La civilisation des parents", est une conférence grand public donnée à Berlin en 1980 en ouverture d?un colloque sur "Vivre avec des enfants". Sous une forme aisément accessible, Elias y relit les rapports parents-enfants à la lumière de sa thèse sur le "processus de civilisation", insistant notamment sur le "devenir-adulte" de l?enfant comme apprentissage de l?autocontrôle, et sur l?allongement de ce processus à mesure des progrès de la "civilisation des m?urs" ; sur les rapports de domination entre parents et enfants, qui tendent à s?atténuer à l?époque contemporaine (ce qui lui permet de critiquer au passage la vision "romantique" et idéalisante qu?avait Philippe Ariès de l?enfance dans l?ancien temps) ; et sur les transformations historiques de l?attachement aux enfants (beaucoup plus fort que par le passé, étant donné la maîtrise accrue du contrôle des naissances) ? l?amour parental étant un fait non pas "naturel" mais social. Ainsi peut-on comprendre le "durcissement de l?interdit de l?usage de la violence de la part des deux parties". |
|  |


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheAu-delà de Freud - Sociologie, psychologie, psychanalyse / Norbert ELIAS