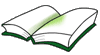| Titre : | Ethnologie de la porte : des passages et des seuils | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Pascal DIBIE, Auteur | | Editeur : | Paris [France] : Métaillé | | Année de publication : | 2012 | | Importance : | 1 vol. (422 p.) | | Présentation : | couv. ill. en coul. | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86424-841-5 | | Langues : | Français | | Résumé : | Qu’est-ce qu’une porte ?
Dans sa définition même elle implique l’existence d’un "dehors", autrement dit
de ce qui est "hors de la porte". Nous y sommes : la porte est d’abord vue de
l’intérieur de la maison par celui qui s’y inscrit... A partir de là tout est à penser :
le dedans, le dehors, l’ouvert, le fermé, le bien-être, le danger, et c’est pour elle
que nous nous sommes institués, nous les hommes, en grands paranoïaques
autant qu’en dieux et en techniciens ! Pas un lieu où nous avons voulu dormir
que nous n’avons barricadé, pas un champ que nous n’avons borné, pas un
temple que nous n’avons chargé, pas une famille ni une ville que nous n’avons protégées. Nos portes sont
partout, issues étroites ou portes monumentales.
Des Magdaléniens d’Etiolles à la porte d’Ishtar à Babylone quelle folie nous a prise? Portiques grecs, arcs de
triomphe romains, Jésus qui prêche aux portes, L’enfer qui s’en invente, notre imaginaire de la porte se
construit petit à petit. On arme les châteaux de pont-levis et de symboles, on enclot les femmes et puis on fait
des Entrées solennelles, on s’invente des étiquettes autant pour les hommes que pour les livres. On dresse
partout des barrières jusqu’à inventer les frontières. La ville s’avance, la société se discipline, se numérote,
s’invente des règles qu’elle affiche aux portes: prestige, convenances, mort, on peut tout lire à la porte de nos
vies. Le folklore s’est emparé des seuils, a nourri nos croyances et nos étranges rites de passage. Nos
semblables d’un ailleurs proche ou lointain n’ont pas fait moins : jnouns et serrures veillent en Afrique pendant
qu’en Chine on calcule encore l’orientation des ouvertures et qu’à chaque porte se joue l’équilibre de l’univers
entier. En Amazonie la porte est en soi alors qu’en Océanie elle est un long chemin d’alliance.
La porte est pour chacun un bonheur et une inquiétude quotidiens tout simplement parce que, de tous nos
objets du quotidien, elle représente un monde inépuisable de pensées.
PASCAL DIBIE est Professeur d’Ethnologie à l’Université Paris Diderot-Paris 7 où il co-dirige le pôle des
sciences de la ville. Il est l’auteur d’une ethnologie d’un village de Bourgogne effectuée à 30 années de distance
qui fait référence : Le Village retrouvé, ethnologie de l’intérieur (Grasset, 1979) et Le village métamorphosé,
révolution dans la France profonde (Plon, 2006). Il est également l’auteur de Ethnologie de la chambre à
coucher traduit en 15 langues et vendu à 30 000 exemplaires (Grasset, 1987, reprise en Suite Métailié, 2000),
La Tribu sacrée, ethnologie des prêtres (Grasset, 1993 reprise en Suite Métailié, 2004), et La Passion du regard,
essai contre les sciences froides (Métailié, 1998). | | Note de contenu : | Bibliographie p.403-418 |
Ethnologie de la porte : des passages et des seuils [texte imprimé] / Pascal DIBIE, Auteur . - Paris (20, rue des Grands Augustins, 75006, France) : Métaillé, 2012 . - 1 vol. (422 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86424-841-5 Langues : Français | Résumé : | Qu’est-ce qu’une porte ?
Dans sa définition même elle implique l’existence d’un "dehors", autrement dit
de ce qui est "hors de la porte". Nous y sommes : la porte est d’abord vue de
l’intérieur de la maison par celui qui s’y inscrit... A partir de là tout est à penser :
le dedans, le dehors, l’ouvert, le fermé, le bien-être, le danger, et c’est pour elle
que nous nous sommes institués, nous les hommes, en grands paranoïaques
autant qu’en dieux et en techniciens ! Pas un lieu où nous avons voulu dormir
que nous n’avons barricadé, pas un champ que nous n’avons borné, pas un
temple que nous n’avons chargé, pas une famille ni une ville que nous n’avons protégées. Nos portes sont
partout, issues étroites ou portes monumentales.
Des Magdaléniens d’Etiolles à la porte d’Ishtar à Babylone quelle folie nous a prise? Portiques grecs, arcs de
triomphe romains, Jésus qui prêche aux portes, L’enfer qui s’en invente, notre imaginaire de la porte se
construit petit à petit. On arme les châteaux de pont-levis et de symboles, on enclot les femmes et puis on fait
des Entrées solennelles, on s’invente des étiquettes autant pour les hommes que pour les livres. On dresse
partout des barrières jusqu’à inventer les frontières. La ville s’avance, la société se discipline, se numérote,
s’invente des règles qu’elle affiche aux portes: prestige, convenances, mort, on peut tout lire à la porte de nos
vies. Le folklore s’est emparé des seuils, a nourri nos croyances et nos étranges rites de passage. Nos
semblables d’un ailleurs proche ou lointain n’ont pas fait moins : jnouns et serrures veillent en Afrique pendant
qu’en Chine on calcule encore l’orientation des ouvertures et qu’à chaque porte se joue l’équilibre de l’univers
entier. En Amazonie la porte est en soi alors qu’en Océanie elle est un long chemin d’alliance.
La porte est pour chacun un bonheur et une inquiétude quotidiens tout simplement parce que, de tous nos
objets du quotidien, elle représente un monde inépuisable de pensées.
PASCAL DIBIE est Professeur d’Ethnologie à l’Université Paris Diderot-Paris 7 où il co-dirige le pôle des
sciences de la ville. Il est l’auteur d’une ethnologie d’un village de Bourgogne effectuée à 30 années de distance
qui fait référence : Le Village retrouvé, ethnologie de l’intérieur (Grasset, 1979) et Le village métamorphosé,
révolution dans la France profonde (Plon, 2006). Il est également l’auteur de Ethnologie de la chambre à
coucher traduit en 15 langues et vendu à 30 000 exemplaires (Grasset, 1987, reprise en Suite Métailié, 2000),
La Tribu sacrée, ethnologie des prêtres (Grasset, 1993 reprise en Suite Métailié, 2004), et La Passion du regard,
essai contre les sciences froides (Métailié, 1998). | | Note de contenu : | Bibliographie p.403-418 |
|  |


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheEthnologie de la porte : des passages et des seuils / Pascal DIBIE