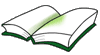Le Fil d’Ariane
Centre de documentation spécialisé en santé mentale
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail d'une collection
Documents disponibles dans la collection


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheFace aux désastres - une conversation à quatre voix sur la folie, le care et les grandes détresses collectives / Anne M. LOVELL
Titre : Face aux désastres - une conversation à quatre voix sur la folie, le care et les grandes détresses collectives Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne M. LOVELL, Auteur ; Stefania PANDOLFO, Auteur ; Veena DAS, Auteur ; Sandra LAUGIER, Auteur Editeur : Paris [France] : Ithaque Année de publication : DL. 2013 Collection : philosophie, anthropologie, psychologie Importance : 1 vol. (203 p.) Présentation : ill. en coul., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-916120-38-6 Langues : Français Résumé : Une nouvelle anthropologie de la folie est en train de naître. Elle n’a plus pour centre de gravité l’étude critique de la répression des déviants et des anormaux. Non qu’elle s’en désintéresse. Elle les retrouve en analysant en détail la fragilité que tout un chacun ressent quand il s’efforce, au quotidien, d’incarner sa subjectivité : de trouver sa voix propre. La folie ainsi revisitée devient une menace pour tous, « une tragédie de l’ordinaire ». Elle surgit quand toute une forme de vie entre en crise – pas seulement le cerveau de tel individu malade, mais l’ensemble du monde social et naturel qu’il partageait avec autrui.
Or rien ne révèle mieux cette tragédie de l’ordinaire que les désastres collectifs extraordinaires où la vulnérabilité foncière des êtres humains est mise à nu. La Nouvelle-Orléans ravagée par Katrina, les bidonvilles de Rabat ou de Delhi sont les théâtres paradoxaux où, dans la détresse et le dénuement, s’inventent de nouvelles manières d’exister et de s’exprimer, et des formes inédites d’attention à l’autre.
Trois anthropologues et une philosophe explorent ici les terrains où cette façon inédite de considérer la condition humaine au prisme de la folie s’est imposée à elles avec force. Elles en tirent les conséquences politiques, éthiques et scientifiques, avec une rigueur nouvelle, en termes de care.Note de contenu : Références bibliographique p.193-204. - Références électroniques et index p.205 Face aux désastres - une conversation à quatre voix sur la folie, le care et les grandes détresses collectives [texte imprimé] / Anne M. LOVELL, Auteur ; Stefania PANDOLFO, Auteur ; Veena DAS, Auteur ; Sandra LAUGIER, Auteur . - Paris (165, rue d'Alésia, 75014, France) : Ithaque, DL. 2013 . - 1 vol. (203 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (philosophie, anthropologie, psychologie) .
ISBN : 978-2-916120-38-6
Langues : Français
Résumé : Une nouvelle anthropologie de la folie est en train de naître. Elle n’a plus pour centre de gravité l’étude critique de la répression des déviants et des anormaux. Non qu’elle s’en désintéresse. Elle les retrouve en analysant en détail la fragilité que tout un chacun ressent quand il s’efforce, au quotidien, d’incarner sa subjectivité : de trouver sa voix propre. La folie ainsi revisitée devient une menace pour tous, « une tragédie de l’ordinaire ». Elle surgit quand toute une forme de vie entre en crise – pas seulement le cerveau de tel individu malade, mais l’ensemble du monde social et naturel qu’il partageait avec autrui.
Or rien ne révèle mieux cette tragédie de l’ordinaire que les désastres collectifs extraordinaires où la vulnérabilité foncière des êtres humains est mise à nu. La Nouvelle-Orléans ravagée par Katrina, les bidonvilles de Rabat ou de Delhi sont les théâtres paradoxaux où, dans la détresse et le dénuement, s’inventent de nouvelles manières d’exister et de s’exprimer, et des formes inédites d’attention à l’autre.
Trois anthropologues et une philosophe explorent ici les terrains où cette façon inédite de considérer la condition humaine au prisme de la folie s’est imposée à elles avec force. Elles en tirent les conséquences politiques, éthiques et scientifiques, avec une rigueur nouvelle, en termes de care.Note de contenu : Références bibliographique p.193-204. - Références électroniques et index p.205 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8268 L-FACE Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible Qu'est-ce que le DSM ? - genèse et transformation de la bible américaine de la psychiatrie / Steeves DEMAZEUX
Titre : Qu'est-ce que le DSM ? - genèse et transformation de la bible américaine de la psychiatrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Steeves DEMAZEUX, Auteur Editeur : Paris [France] : Ithaque Année de publication : Cop. 2013 Collection : philosophie, anthropologie, psychologie Importance : 1 vol. (251 p.) Présentation : couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-916120-36-2 Langues : Français Résumé : Publiée en 1980 par l’Association américaine de psychiatrie, la 3e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou DSM-III, a marqué une cassure dans le champ de la médecine mentale. « Simple » classification systématique des maladies mentales au départ, son influence a largement débordé du champ clinique. Les catégories du DSM-III (et de ses successeurs, jusqu’au DSM‑5) ont forcé à une recomposition majeure toute la recherche moderne en psychiatrie, en psychopharmacologie et en épidémiologie, altérant les conditions de prise en charge des malades, jusqu’à s’élever au rang de normes dans les évaluations contemporaines en santé mentale.
Or le DSM a fait l’objet d’un nombre considérable de reproches. Car si certains se réjouissent que le DSM ait renvoyé aux poubelles de l’histoire l’ancienne psychiatrie « pré-scientifique », la psychanalyse et, en général, les opinions subjectives sur la folie, d’autres y voient « la mort de la clinique », une version à la fois scientiste et déshumanisante de la psychiatrie.
Toutes ces objections ont un point commun : elles reposent sur une connaissance très partielle de l’histoire du DSM, du contexte de son élaboration, et des raisons complexes, épistémologiques comme institutionnelles, qui ont présidé à ses révisions successives. Pourquoi le DSM fait-il donc si peur ? Et ceux qui prônent ce nouveau style scientifique en psychiatrie y ont-ils gagné autant qu’ils croient ?
Il convient donc de préciser la nature de la révolution épistémologique opérée par les DSM.
Qui furent les psychiatres à l’origine de ce projet ? Quelles furent leurs cibles polémiques et leurs méthodes ? Quelle conception, enfin, se faisaient-ils de l’objectivité en psychiatrie ?
Répondant en détail à ces questions, Steeves Demazeux révèle l’étonnante singularité du projet qui a conduit au DSM, pour mieux réfléchir aux difficultés qu’il continue de soulever.Note de contenu : Note sur les références et les index p.253 Qu'est-ce que le DSM ? - genèse et transformation de la bible américaine de la psychiatrie [texte imprimé] / Steeves DEMAZEUX, Auteur . - Paris (165, rue d'Alésia, 75014, France) : Ithaque, Cop. 2013 . - 1 vol. (251 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (philosophie, anthropologie, psychologie) .
ISBN : 978-2-916120-36-2
Langues : Français
Résumé : Publiée en 1980 par l’Association américaine de psychiatrie, la 3e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou DSM-III, a marqué une cassure dans le champ de la médecine mentale. « Simple » classification systématique des maladies mentales au départ, son influence a largement débordé du champ clinique. Les catégories du DSM-III (et de ses successeurs, jusqu’au DSM‑5) ont forcé à une recomposition majeure toute la recherche moderne en psychiatrie, en psychopharmacologie et en épidémiologie, altérant les conditions de prise en charge des malades, jusqu’à s’élever au rang de normes dans les évaluations contemporaines en santé mentale.
Or le DSM a fait l’objet d’un nombre considérable de reproches. Car si certains se réjouissent que le DSM ait renvoyé aux poubelles de l’histoire l’ancienne psychiatrie « pré-scientifique », la psychanalyse et, en général, les opinions subjectives sur la folie, d’autres y voient « la mort de la clinique », une version à la fois scientiste et déshumanisante de la psychiatrie.
Toutes ces objections ont un point commun : elles reposent sur une connaissance très partielle de l’histoire du DSM, du contexte de son élaboration, et des raisons complexes, épistémologiques comme institutionnelles, qui ont présidé à ses révisions successives. Pourquoi le DSM fait-il donc si peur ? Et ceux qui prônent ce nouveau style scientifique en psychiatrie y ont-ils gagné autant qu’ils croient ?
Il convient donc de préciser la nature de la révolution épistémologique opérée par les DSM.
Qui furent les psychiatres à l’origine de ce projet ? Quelles furent leurs cibles polémiques et leurs méthodes ? Quelle conception, enfin, se faisaient-ils de l’objectivité en psychiatrie ?
Répondant en détail à ces questions, Steeves Demazeux révèle l’étonnante singularité du projet qui a conduit au DSM, pour mieux réfléchir aux difficultés qu’il continue de soulever.Note de contenu : Note sur les références et les index p.253 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8008 L-DEMA Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible