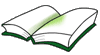Le Fil d’Ariane
Centre de documentation spécialisé en santé mentale
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail de l'auteur
Auteur Jean-Claude QUENTEL
Documents disponibles écrits par cet auteur


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheL'adolescence aux marges du social / Jean-Claude QUENTEL
Titre : L'adolescence aux marges du social Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude QUENTEL Autre Editeur : Editions Fabert Année de publication : 2011 Importance : 60 Langues : Français Catégories : Adolescent Mots-clés : Adolescent Résumé : L'adolescence semble être aujourd'hui une réalité évidente. Les médias, les parents, mais aussi les professionnels ne cessent pourtant d'en débattre. Et la littérature abonde sur les difficultés de l'adolescent. Qu'en est-il donc de son statut ? Quel rapport l'adolescence entretient-elle avec la puberté ? S'agit-il d'une phase naturelle du développement, comme l'ont soutenu les psychologues ? Cet ouvrage rappelle que l'adolescence constitue d'abord une réalité sociale, correspondant à un montage opéré par les sociétés occidentales. Elle n'est toutefois que la forme que vient prendre dans ces sociétés une problématique d'ordre général qui est la sortie de l'enfance. Dès lors, ce sont les processus que celle-ci recouvre qui doivent être interrogés. Leur mise en évidence permet d'être mieux armé pour faire face aux questions que l'adolescence provoque de nos jours dans nos sociétés.
------------------------------------------
L'adolescence, qui peut paraître de nos jours une réalité évidente, soulève en fait bien des questions. Les médias y reviennent régulièrement, mais les parents et les professionnels s'interrogent tout autant à son propos. La littérature abonde sur les difficultés de l'adolescent. Peu de travaux s'intéressent toutefois à la question de son réel statut. Qu'en est-il en fin de compte de l'adolescence ? Elle n'est pas à confondre avec la puberté, même si celle-ci la conditionne physiologiquement. Doit-elle être comprise comme une phase naturelle du développement de l'homme, comme l'ont soutenu les psychologues psychogénéticiens ? Tout dément une telle approche de la question qui a pourtant longtemps prévalu au XXè siècle. De quel point de vue l'adolescence existe-t-elle, en dehors du fait que le terme s'est peu à peu imposé dans nos sociétés depuis plus d'un siècle et demi ? Étudiée à travers plusieurs disciplines, l'adolescence constitue d'abord une réalité sociale ou, comme l'énoncent les sociologues, une « construction sociale ». Elle correspond, en d'autres termes, à un montage opéré par les sociétés occidentales à un moment donné de leur histoire. Elle n'a donc pas toujours existé et elle n'est pas observable dans toutes les sociétés. L'adolescence n'est en fait que la forme de réponse apportée par nos sociétés à une question qui concerne toute communauté et qui est donc générale, celle de la sortie de l'enfance. Les sociétés qui pratiquent l'initiation insistent sur le fait qu'il faut « mourir à l'enfance » pour émerger au social. Mais les psychanalystes évoquent de même la nécessité d'un « meurtre de l'enfant » en nous. Le conflit interne à la personne qui s'ensuit ouvre à des processus qui définissent ce que l'on peut appeler « l'émergence à la personne ». Ce sont ces processus qui se trouvent ici interrogés. Leur explicitation fonde un recul qui permet d'être mieux armé pour faire face aux questions que l'adolescence provoque aujourd'hui dans nos sociétés.
Sommaire
L'adolescence, une réalité sociale . . . . . . . . 9
L'adolescence n'existe pas . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Une construction sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Un concept psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mourir à l?enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Les enseignements de l'ethnologie . . . . . . . . . . 19
« On tue un enfant » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Un conflit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
L'émergence à la personne . . . . . . . . . . . . . . 31
La contingence de l'être . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La recherche des origines . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
L?appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57L'adolescence aux marges du social [texte imprimé] / Jean-Claude QUENTEL . - [S.l.] : Editions Fabert, 2011 . - 60.
Langues : Français
Catégories : Adolescent Mots-clés : Adolescent Résumé : L'adolescence semble être aujourd'hui une réalité évidente. Les médias, les parents, mais aussi les professionnels ne cessent pourtant d'en débattre. Et la littérature abonde sur les difficultés de l'adolescent. Qu'en est-il donc de son statut ? Quel rapport l'adolescence entretient-elle avec la puberté ? S'agit-il d'une phase naturelle du développement, comme l'ont soutenu les psychologues ? Cet ouvrage rappelle que l'adolescence constitue d'abord une réalité sociale, correspondant à un montage opéré par les sociétés occidentales. Elle n'est toutefois que la forme que vient prendre dans ces sociétés une problématique d'ordre général qui est la sortie de l'enfance. Dès lors, ce sont les processus que celle-ci recouvre qui doivent être interrogés. Leur mise en évidence permet d'être mieux armé pour faire face aux questions que l'adolescence provoque de nos jours dans nos sociétés.
------------------------------------------
L'adolescence, qui peut paraître de nos jours une réalité évidente, soulève en fait bien des questions. Les médias y reviennent régulièrement, mais les parents et les professionnels s'interrogent tout autant à son propos. La littérature abonde sur les difficultés de l'adolescent. Peu de travaux s'intéressent toutefois à la question de son réel statut. Qu'en est-il en fin de compte de l'adolescence ? Elle n'est pas à confondre avec la puberté, même si celle-ci la conditionne physiologiquement. Doit-elle être comprise comme une phase naturelle du développement de l'homme, comme l'ont soutenu les psychologues psychogénéticiens ? Tout dément une telle approche de la question qui a pourtant longtemps prévalu au XXè siècle. De quel point de vue l'adolescence existe-t-elle, en dehors du fait que le terme s'est peu à peu imposé dans nos sociétés depuis plus d'un siècle et demi ? Étudiée à travers plusieurs disciplines, l'adolescence constitue d'abord une réalité sociale ou, comme l'énoncent les sociologues, une « construction sociale ». Elle correspond, en d'autres termes, à un montage opéré par les sociétés occidentales à un moment donné de leur histoire. Elle n'a donc pas toujours existé et elle n'est pas observable dans toutes les sociétés. L'adolescence n'est en fait que la forme de réponse apportée par nos sociétés à une question qui concerne toute communauté et qui est donc générale, celle de la sortie de l'enfance. Les sociétés qui pratiquent l'initiation insistent sur le fait qu'il faut « mourir à l'enfance » pour émerger au social. Mais les psychanalystes évoquent de même la nécessité d'un « meurtre de l'enfant » en nous. Le conflit interne à la personne qui s'ensuit ouvre à des processus qui définissent ce que l'on peut appeler « l'émergence à la personne ». Ce sont ces processus qui se trouvent ici interrogés. Leur explicitation fonde un recul qui permet d'être mieux armé pour faire face aux questions que l'adolescence provoque aujourd'hui dans nos sociétés.
Sommaire
L'adolescence, une réalité sociale . . . . . . . . 9
L'adolescence n'existe pas . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Une construction sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Un concept psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mourir à l?enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Les enseignements de l'ethnologie . . . . . . . . . . 19
« On tue un enfant » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Un conflit interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
L'émergence à la personne . . . . . . . . . . . . . . 31
La contingence de l'être . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La recherche des origines . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
L?appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 6266 L-QUEN Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible La personne au principe du social : Les leçons de l'adolescence / Jean-Claude QUENTEL
Titre : La personne au principe du social : Les leçons de l'adolescence Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude QUENTEL, Auteur Importance : 1 vol. (244 p.) Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-07-301300-2 Prix : 21 EUR Langues : Français Catégories : Adolescent
Identité individuelle
Institution
SujetIndex. décimale : 155.5 Résumé : Le concept de Personne, tel qu'on l'entend ici, désigne la capacité qui permet à l'homme à la fois de se vivre comme une subjectivité singulière et de participer au social. L'argumentation prend ici appui sur l'expérience de l'adolescent, son fonctionnement étant en effet révélateur des processus que suppose la Personne. Ce qui se joue à cette période de la vie oblige à comprendre que, loin d'être acquise d'emblée, c'est à une époque relativement tardive de son existence, après les années de l'enfance au sens strict, que la Personne émerge en l'homme. Elle se spécifie dès lors clairement par rapport aux autres capacités dont celui-ci peut faire preuve dès la première enfance, à savoir le langage, mais également l'habileté technique et le désir. Processus général, donc anthropologique au plein sens de ce terme, la Personne suppose fondamentalement une abstraction, en l'occurrence une prise de distance radicale par rapport au mode de rapports immédiats dans lequel l'être humain se trouve naturellement pris. Cette abstraction se fait ici absence, à soi-même en même temps qu'à autrui. Pour autant, l'homme n'en demeure aucunement à ce moment d'abstraction qui n'est qu'implicite et il investit contradictoirement son être dans des situations sociales diverses. Le présent ouvrage trouve sa source dans les travaux du linguiste Jean Gagnepain, auquel on doit d'avoir éclairé, le premier, ce processus paradoxal ou "dialectique" constitutif de la Personne. Mais, au-delà de la Personne, c'est toute la dimension pratique de la rationalité humaine que cette perspective d'analyse invite à repenser, de l'emploi du signe au sens de la norme, en passant par l'usage de l'outil. La personne au principe du social : Les leçons de l'adolescence [texte imprimé] / Jean-Claude QUENTEL, Auteur . - [s.d.] . - 1 vol. (244 p.) ; 23 cm.
ISBN : 978-2-07-301300-2 : 21 EUR
Langues : Français
Catégories : Adolescent
Identité individuelle
Institution
SujetIndex. décimale : 155.5 Résumé : Le concept de Personne, tel qu'on l'entend ici, désigne la capacité qui permet à l'homme à la fois de se vivre comme une subjectivité singulière et de participer au social. L'argumentation prend ici appui sur l'expérience de l'adolescent, son fonctionnement étant en effet révélateur des processus que suppose la Personne. Ce qui se joue à cette période de la vie oblige à comprendre que, loin d'être acquise d'emblée, c'est à une époque relativement tardive de son existence, après les années de l'enfance au sens strict, que la Personne émerge en l'homme. Elle se spécifie dès lors clairement par rapport aux autres capacités dont celui-ci peut faire preuve dès la première enfance, à savoir le langage, mais également l'habileté technique et le désir. Processus général, donc anthropologique au plein sens de ce terme, la Personne suppose fondamentalement une abstraction, en l'occurrence une prise de distance radicale par rapport au mode de rapports immédiats dans lequel l'être humain se trouve naturellement pris. Cette abstraction se fait ici absence, à soi-même en même temps qu'à autrui. Pour autant, l'homme n'en demeure aucunement à ce moment d'abstraction qui n'est qu'implicite et il investit contradictoirement son être dans des situations sociales diverses. Le présent ouvrage trouve sa source dans les travaux du linguiste Jean Gagnepain, auquel on doit d'avoir éclairé, le premier, ce processus paradoxal ou "dialectique" constitutif de la Personne. Mais, au-delà de la Personne, c'est toute la dimension pratique de la rationalité humaine que cette perspective d'analyse invite à repenser, de l'emploi du signe au sens de la norme, en passant par l'usage de l'outil. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9206 L-QUEN Livres Le Fil d'Ariane Livre Disponible